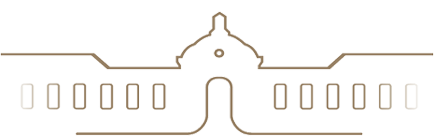Quand la formation professionnelle déqualifie
Résumé
La loi du 5 septembre 2018, si elle modifie profondément le paysage de la formation professionnelle dans ses aspects
institutionnels, financiers, ... nous semble en revanche en continuité avec les évolutions législatives et réglementaires qu’a
connu notre pays depuis près de deux décennies dans le domaine des certifications professionnelles. Au nom d’une
flexibilisation des rapports entre éducation et emploi, exacte réplique de la flexsécurité sensée régir le monde du travail, la
France s’est progressivement attachée à faire évoluer son système de diplomation (Maillard, 2015). A l’origine, le diplôme
constitue, pour son possesseur, le signe d’une qualification. C’est le cas, par exemple, du CAP qui, dès son origine en 1911,
permet de distinguer une élite ouvrière, les ouvriers qualifiés (Brucy, Maillard, & Moreau, 2013).
Cependant, dès 2002, avec la loi de modernisation sociale fondatrice du répertoire national des certifications professionnelles
et de la VAE et plus encore celle de 2014, créant les blocs de compétences, ce lien direct et étroit entre diplôme (ou
certification professionnelle) et qualification se délite (Balas, à paraitre), rendant le paysage de la certification professionnelle
sans doute plus souple mais surtout moins lisible et moins protecteur pour les individus. C’est sur cette base affaiblie que la loi
du 5 septembre 2018 propose de faire reposer l’exercice de la liberté individuelle de choisir son avenir professionnel.
Nous tenterons de documenter cette tendance à travers une analyse règlementaire mais aussi des exemples issues
d’interventions dans plusieurs milieux professionnels portant sur la conception et la mise en œuvre de certifications
professionnelles.